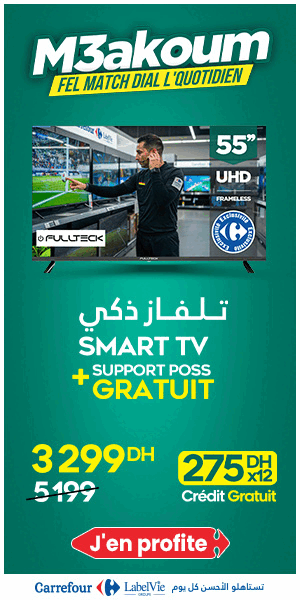Le premier semestre 2025 a plus que jamais confirmé l’écart croissant entre les poids lourds de la microfinance marocaine et les structures plus modestes, toujours en quête d’équilibre. Dans un secteur en pleine recomposition, les grandes institutions poursuivent leur dynamique d’expansion, notamment sur le segment de la très petite entreprise, quand les acteurs plus petits peinent à soutenir leur activité et à trouver des relais de financement pérennes.
Les chiffres semestriels de Jaida, en sa qualité de bailleur de fonds important pour les associations de microcrédit, offrent un éclairage précis sur cette évolution à deux vitesses. L’encours brut financé par Jaida atteint 1,07 milliard de dirhams au 30 juin 2025, en progression de 7,3 % sur un an. Cette hausse est portée presque exclusivement par les besoins croissants des grandes associations, désormais largement tournées vers le financement des TPME.
Cette orientation stratégique se reflète également dans la structure du portefeuille de Jaida, où les crédits à moyen terme représentent plus de 71 % des engagements. Les durées de financement s’allongent, les montants progressent, et les profils bénéficiaires évoluent, témoignant d’une montée en gamme du secteur.
En parallèle, plusieurs associations de plus petite taille restent confrontées à des contraintes persistantes : faiblesse des fonds propres, coûts de refinancement élevés, accès limité aux ressources longues. Ces freins structurels limitent leur capacité à suivre le rythme imposé par les leaders du marché. Certaines peinent à respecter les normes prudentielles ou à absorber les chocs de conjoncture, freinant ainsi leur développement.
Dans ce contexte contrasté, Jaida affiche des indicateurs solides. Son produit net bancaire progresse de 5 %, porté par la hausse du portefeuille. Le résultat net s’établit à 20 millions de dirhams, en croissance de 18 % sur un an, malgré une légère augmentation du coût du risque. Les charges générales d’exploitation restent contenues, permettant une amélioration du coefficient d’exploitation.
Cette performance reflète la concentration croissante du marché autour de quelques grandes entités capables d’absorber davantage de financements et de porter des projets de transformation à plus grande échelle.
Face à cette dynamique, la question de l’inclusion demeure posée. La fragilité persistante des petits opérateurs pourrait, à terme, creuser les écarts d’accès au microcrédit dans certaines zones, notamment rurales où perdurent les segments à faible revenu. Afin d’éviter un paysage aussi polarisé, des mécanismes de soutien ciblés semblent plus que jamais nécessaires.