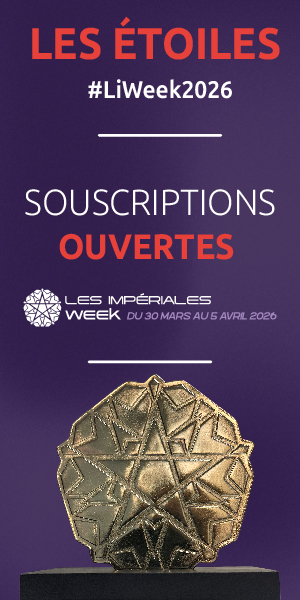Lancé en 2020 sur instruction du Roi Mohammed VI, le chantier de généralisation de la protection sociale au Maroc poursuit sa mise en œuvre à un rythme soutenu. Cette réforme d’ampleur, portée au plus haut niveau de l’État, repose sur une architecture légale et opérationnelle qui s’est précisée au fil des dernières années, avec pour horizon l’année 2025.
Le discours du souverain devant le Parlement, le 9 octobre 2020, a marqué un tournant dans la stratégie nationale de lutte contre la précarité. En appelant à l’élargissement de la protection sociale à l’ensemble des citoyens, le Roi a donné l’impulsion politique d’un projet visant à garantir un accès plus équitable aux soins, aux aides familiales, à une retraite et à une indemnité en cas de perte d’emploi. Ce chantier s’inscrit dans une vision de justice sociale qui prend appui sur l’inclusion des franges les plus vulnérables de la population.
Ces directives ont été traduites dans la loi-cadre 09.21, promulguée le 23 mars 2021. Le texte pose les fondements législatifs de cette politique, fixe les principes d’intervention de l’État et encadre les modalités de mise en œuvre du dispositif. Il s’articule autour de quatre axes majeurs, chacun correspondant à une composante essentielle de la couverture sociale universelle. La mise en place de ces piliers s’est intensifiée à mesure que s’approchait l’échéance de 2025.
Premier chantier activé : la généralisation de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) à toutes les catégories de la population. Jusqu’en 2022, seuls certains segments en bénéficiaient. Depuis décembre de la même année, les anciens bénéficiaires du régime d’assistance médicale RAMED ont été intégrés dans l’AMO de base. Cela représente environ 4 millions de familles, soit plus de 10 millions de personnes, pour un budget annuel de 9,5 milliards de dirhams, entièrement pris en charge par l’État.
Le déploiement s’est étendu à d’autres publics. Environ 2,4 millions de travailleurs non salariés, dont des commerçants, des artisans ou des professions libérales, ont été affiliés, permettant à plus de 6 millions de personnes, incluant ayants droit, de rejoindre le régime. Un dispositif complémentaire, baptisé AMO Achamil, cible quant à lui les individus sans activité professionnelle mais en capacité de cotiser.
Les effets sont tangibles. En juillet 2025, le Chef du gouvernement a annoncé que plus de 4 millions de ménages, soit 11,4 millions de citoyens, avaient intégré l’AMO de base sans contribuer financièrement. Le taux de couverture est ainsi passé de 42,2 % avant le lancement du chantier à 88 %. La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), chargée de la gestion de l’AMO, a vu le nombre de ses assurés grimper de 8 à 25 millions en quelques années.
Le deuxième pilier de la réforme porte sur la généralisation des allocations familiales. Lancé entre 2023 et 2024, ce programme vise à compenser les inégalités d’accès aux aides publiques pour les enfants en âge de scolarité. Il repose sur le Registre social unifié (RSU), un outil de ciblage numérique qui attribue à chaque ménage un identifiant et un score socio-économique déterminant l’éligibilité aux aides.
À la fin du mois de septembre 2024, quelque 4,18 millions de familles avaient perçu une aide sociale directe. Parmi elles, 2,36 millions ont reçu des allocations familiales, et 1,55 million ont bénéficié d’allocations forfaitaires. En parallèle, une aide exceptionnelle à la rentrée a été versée à 1,66 million d’élèves du primaire, 959.000 collégiens et 438.000 lycéens, pour un montant global de 18,54 milliards de dirhams mobilisés depuis décembre 2023.
Cette politique de soutien s’est intensifiée en 2025. En avril, le gouvernement annonçait que près de 4 millions de citoyens avaient perçu une aide directe, soit 12 millions de personnes touchées au total. Parmi elles, 5,5 millions d’enfants, plus d’un million de seniors de plus de 60 ans et plus de 420.000 veuves, dont près de 340.000 sans enfants. Depuis le lancement du programme, le montant global des aides versées dépasse les 34 milliards de dirhams.
Le troisième pilier concerne l’élargissement de la couverture retraite. Objectif affiché : intégrer d’ici fin 2025 quelque 5 millions de travailleurs actifs ne disposant d’aucune pension. Il s’agit notamment des indépendants, des agriculteurs ou des travailleurs de l’économie informelle, jusqu’ici écartés du système de retraite. Le gouvernement entend instaurer un régime national dédié aux non-salariés, avec des règles de cotisation harmonisées, afin de réduire les disparités entre les différentes couches socio-professionnelles et assurer la viabilité financière du système.
Le quatrième et dernier pilier, encore peu développé, vise à généraliser l’indemnité pour perte d’emploi (IPE). Actuellement limitée, cette prestation a bénéficié à seulement 26.077 personnes en 2023. Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) recommande une refonte du dispositif avec l’instauration d’un régime assurantiel pour les salariés et d’un mécanisme d’assistance pour les travailleurs indépendants. Ce nouveau système serait assorti de mesures d’accompagnement actives pour favoriser le retour à l’emploi.
L’ensemble de ce dispositif repose sur une architecture budgétaire évaluée à 51 milliards de dirhams par an à partir de 2025. Cette enveloppe comprend 14 milliards pour l’AMO, 20 milliards pour les allocations familiales, 16 milliards pour la réforme des retraites et 1 milliard pour l’IPE. D’autres projections, selon les sources et les scénarios, évoquent une charge oscillant entre 29 et 39 milliards de dirhams.
Au cœur de cette politique sociale, le Registre social unifié, mis en place par la loi 72.18, occupe une fonction centrale. Il collecte les données socio-économiques des ménages, les analyse et leur attribue un score de vulnérabilité. Ce mécanisme permet d’orienter les aides de manière plus fine, en évitant les erreurs de ciblage. L’Agence nationale des registres (ANR), en charge du système, délivre à chaque foyer un identifiant numérique unique, garantissant une traçabilité et une transparence accrues.
Parallèlement, un programme d’aide au logement a été instauré début 2024. Il offre une subvention directe à l’achat d’un premier bien immobilier. Deux formules sont prévues : 100.000 dirhams pour un logement coûtant jusqu’à 300.000 dirhams TTC, et 70.000 dirhams pour un bien dont le prix se situe entre 300.000 et 700.000 dirhams TTC. Cette aide est également ouverte aux Marocains résidant à l’étranger, qui représentent 25 % des 63.000 bénéficiaires recensés depuis le lancement. La plateforme numérique dédiée, daamsakane.ma, a déjà enregistré plus de 114.000 demandes.
Ces différents programmes, étayés par un arsenal juridique et une mobilisation financière conséquente, traduisent une volonté politique affirmée d’ancrer le Maroc dans une logique d’État social. L’ensemble du dispositif repose sur une approche structurée, appuyée sur des outils numériques, et mise en œuvre progressive selon les priorités fixées par les autorités.