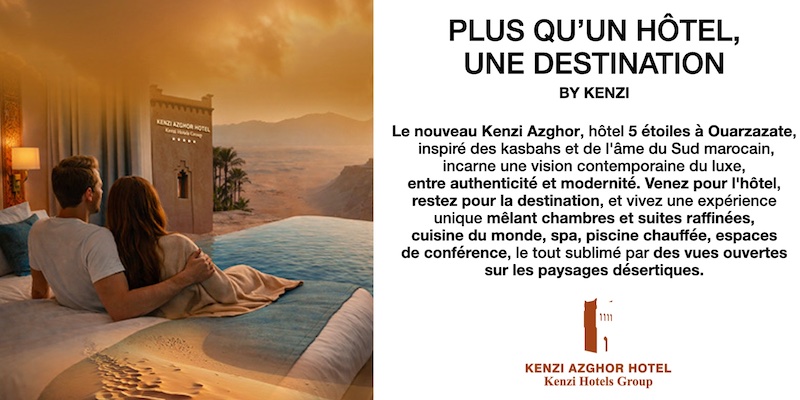La production nationale de dattes devrait atteindre 160.000 tonnes pour la campagne agricole 2025-2026, soit une progression de 55 % par rapport à la saison précédente. Cette estimation, annoncée mercredi à Erfoud par le ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, intervient à l’ouverture de la 14e édition du Salon international des dattes au Maroc.
Ce bond s’explique par des conditions climatiques particulièrement favorables dans les principales zones de production, notamment dans la région de Drâa-Tafilalet, qui concentre à elle seule 76 % de l’offre nationale. Les régions de Souss-Massa et de l’Oriental complètent le tableau avec une part de 11 % chacune.
Des températures hivernales modérées, suivies de précipitations au printemps, ont contribué à améliorer le processus de floraison et la maturation des fruits, indique le ministère. La filière phoenicicole confirme ainsi sa solidité malgré les contraintes hydriques persistantes.
Portée par la dynamique initiée avec le Plan Maroc Vert puis renforcée par la stratégie Génération Green 2020-2030, la production nationale de dattes a presque doublé en moins de vingt ans, passant de 90.400 tonnes en 2008 à 160.000 tonnes en 2025.
Au-delà de ses performances agricoles, la culture du palmier dattier revêt un rôle économique et social de premier plan. Elle génère jusqu’à 2 milliards de dirhams de chiffre d’affaires annuel et représente environ 3,6 millions de journées de travail. Près de deux millions de Marocains en dépendent directement ou indirectement, dans des territoires souvent fragiles.
Sur le plan environnemental, cette culture joue un rôle essentiel dans la lutte contre la désertification et la préservation des écosystèmes oasiens.
Le Salon international des dattes, qui se tient jusqu’au 2 novembre, réunit cette année quelque 230 exposants et attend plus de 90.000 visiteurs. Placé sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, cet événement constitue un moment clé pour les acteurs de la filière et un espace de valorisation de savoir-faire ancestraux au cœur des zones oasiennes.