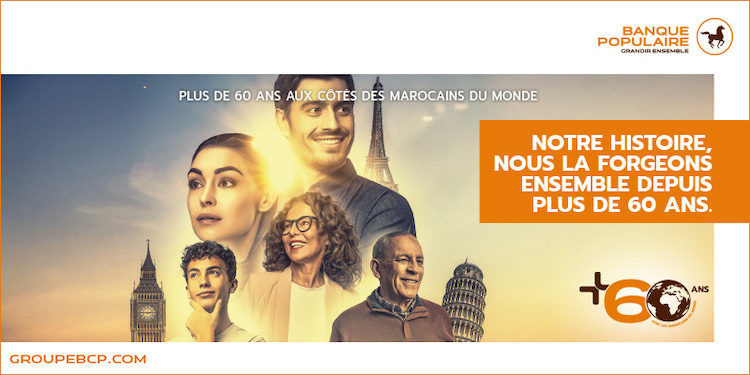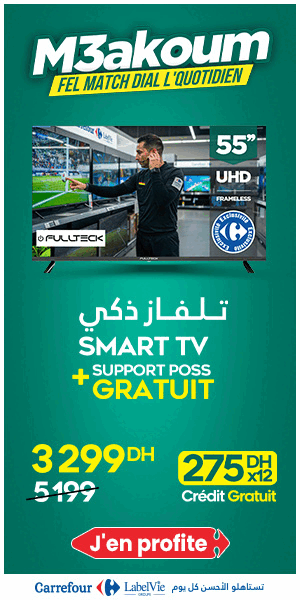À Maarif (Casablanca), Sara, 27 ans, ajuste sa caméra avant de lancer un live sur une appli d’apprentissage de langues. « Je ne voulais plus répondre à un patron, » explique-t-elle, les yeux fixés sur l’écran. « J’avais l’impression de perdre mon temps à attendre un emploi. Là, je décide moi-même du rythme, des missions. »
Le Maroc connaît depuis quelques années un essor palpable du travail indépendant. Confrontés à un chômage des diplômés estimé à plus de 30 %, de nombreux jeunes voient dans le freelancing et l’entrepreneuriat une échappatoire à un système rigide. Le statut d’autoentrepreneur est devenu un recours pragmatique, offrant une porte vers l’activité professionnelle sans passer par la case embauche.
Toujours à Casablanca, Mehdi, 29 ans, ancien ingénieur sans opportunité de poste stable, décide de se lancer dans la création de contenus numériques : vidéos, newsletters, conseils marketing. « J’avais des connaissances, mais aucun emploi ne m’offrait de terrain pour les exprimer. Mon patron aurait mis des barrières. En auto, je me casse la tête, mais je sens que je construis quelque chose pour demain. »
Les plateformes nationales de freelance (Freelancer.ma, Jobbers, etc.) enregistrent une croissance constante des inscriptions. Elles servent de pont entre des jeunes talents isolés et des clients locaux ou étrangers. Pour beaucoup, ces structures donnent une visibilité qu’ils n’auraient pas eue autrement.
Mais le chemin est semé d’embûches. « On me demande de fournir un historique de missions, de prouver des références que je n’ai pas encore, » dit Lina, 25 ans, community manager indépendante. « Je suis dans une boucle où je dois prouver que je suis déjà experte pour décrocher des contrats. »
Les obstacles systémiques sont réels : absence de sécurités sociales équivalentes, difficulté d’accès au crédit, fluctuations des revenus. Certains jeunes retournent à des emplois à temps partiel pour stabiliser leurs revenus. Pourtant, beaucoup perçoivent le salariat comme une cage invisible — une promesse rare de stabilité contre une routine subie.
Paradoxalement, l’aspiration au sens est au cœur du mouvement. Ce qui attire ces jeunes n’est pas seulement l’autonomie, mais la possibilité d’aligner leurs valeurs — impact social, création, liberté — avec leur activité. Pour eux, travailler ne doit plus être subir.
Ce refus du salariat n’est pas uniforme : il diffère selon le secteur, le niveau d’études, les ressources familiales. Dans certaines villes secondaires, où les réseaux professionnels sont faibles, le freelancing peine à s’imposer. Le manque d’infrastructures (Internet de qualité, espaces de coworking) freine aussi les ambitions.
Mais ce que révèle ce mouvement, c’est une inflexion culturelle : pour une génération qui a grandi avec les réseaux, l’idée de durée dans l’emploi est moins sacrée qu’autrefois. On valorise davantage les projets, les initiatives, le « faire pour soi ». Et dans ce creuset, on voit naître des jeunes bâtisseurs d’un modèle de travail qui correspond à ce qu’ils sont, avec ses risques, ses doutes, mais aussi ses libertés.
De Glovo à inDrive, les nouvelles routes du travail
Il existe aussi des applis qyu incarnent une autre forme de travail. Elles sont moins un employeur, plus des plateformes d’intermédiation. « Je passe des heures à scruter l’appli dans l’espoir qu’une course vienne », confie Kamal, 24 ans, livreur à moto pour Glovo depuis plus d’un an. « Si je suis disponible, je lâche tout ; sinon, je compte sur d’autres jours. »
Le fonctionnement est clair : un “coursier” ou “chauffeur partenaire” choisit quand il se connecte, quelles missions il accepte. C’est la flexibilité vantée par ces plateformes. Glovo affiche une structure contractuelle dans ses conditions d’utilisation qui traite ses partenaires comme des prestataires indépendants, et non comme des salariés. inDrive par exemple permet au conducteur de proposer ses propres tarifs pour certaines courses, donnant une marge de manœuvre dans les négociations avec les passagers.
Mais cette liberté affichée masque des réalités plus dures. Les revenus fluctuent, les coûts pèsent (carburant, entretien, frais de connexion internet, amortissement du véhicule). La rentabilité dépend d’un volume de courses élevé, sous peine de devoir rallonger les horaires. Les suspensions de compte, sans explication claire, existent : les coursiers dénoncent des cas de “verrouillage” arbitraire sans recours. Lors d’un rassemblement récent à Casablanca, des livreurs Glovo ont manifesté devant le siège de l’UMT pour réclamer de meilleures conditions, dénonçant notamment des tarifs de base jugés trop faibles (6 dirhams par course) face aux charges engagées.
Certains choisissent ces plateformes par nécessité : faute d’emploi stable ou de perspectives dans le secteur classique. « Je n’ai pas trouvé de poste bien payé dans mon domaine de formation », explique Leïla, 26 ans, qui combine coursiers Glovo et projets freelances. « Au moins ici, je vois des “missions” même si ça ne paie pas toujours bien. »
L’insécurité est omniprésente. Le métier de livreur à deux roues est dangereux — collisions, conditions de circulation, fatigue — et la protection sociale est souvent inexistante. Selon des reportages, certains livreurs subissent des accidents graves sans indemnité décente, et les assurances proposées sont limitées.
Les plateformes, pour leur part, affirment offrir des assurances obligatoires pour les coursiers autoentrepreneurs, couvrant l’hospitalisation ou les dommages à des tiers, mais leurs modalités sont critiquées pour leur étendue restreinte et les plafonds faibles.
Le cas de “Yangoo” est plus flou. Yango Group, plateforme internationale de mobilité et de livraison, est active dans plusieurs pays africains, mais son activité VTC à Casablanca a été suspendue en 2023 par les autorités pour non‑respect des autorisations de transport.
Lorsque Yango opérait, certains jeunes envisageaient de devenir chauffeurs partenaires, espérant profiter de l’essor d’un nouvel acteur. Aujourd’hui, avec la suspension, beaucoup restent dans l’attente ou rebasculent vers d’autres applis.
Cette nouvelle forme de travail brouille les catégories. Ces jeunes ne veulent pas des horaires fixes, d’un patron imposé ou d’un bureau. Ils veulent qu’on reconnaisse leur effort, qu’il y ait une sécurité de base, et surtout qu’on valorise le risque pris chaque jour dans les rues. Le dilemme est là : accepter les contraintes d’un système numérique pour gagner un peu de liberté, sans pour autant tomber dans le piège d’une quasi-précarité déguisée.