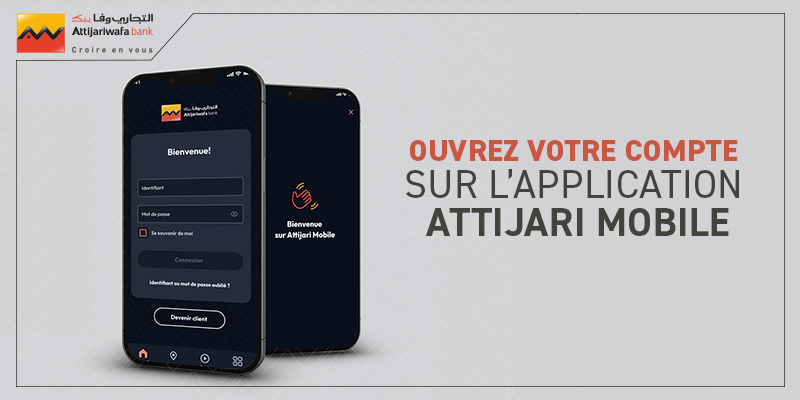Bien différente de la culture européenne, la culture québécoise se distingue par son accueil et son ouverture à la diversité. Cette particularité fait en sorte que les immigrants, quelles que soient leurs origines, peuvent exprimer pleinement leur culture et pratiquer leur religion. Cependant, aussi inclusif que puisse être un gouvernement, il existe des limites et des lignes rouges à ne pas franchir. Le Québec, marqué par une histoire où la religion a longtemps exercé une influence dominante, tient aujourd’hui au principe de la laïcité comme un pilier fondamental de son identité. Aussi, la pratique de la religion peut être considérée comme une sorte d’aveuglement ou comme un manque de discernement. Il ne faut donc pas interpréter l’acceptation de l’autre dont fait preuve le Québec comme une acceptation de la religion comme telle.
Ainsi, le contrat social tacite qui unit les Québécois de souche et les nouveaux arrivants repose sur un équilibre fragile : « vivre et laisser vivre ». Toutefois, ce contrat n’est pas toujours respecté de part et d’autre. Certains expriment ouvertement leurs désaccords, d’autres ne philosophent pas sur la situation tandis que certains préfèrent se murer dans le silence. Ces tensions s’illustrent à travers les débats enflammés sur les réseaux sociaux, les humoristes qui tournent en dérision les sensibilités culturelles et les nouvelles lois qui, pour certains, résonnent comme des rappels à l’ordre abrupts.
Au Québec, la bienséance occupe une place centrale. Être bien perçu par son entourage est une valeur partagée autant par les natifs que par les immigrants. Pourtant, cette quête d’harmonie sociale s’accompagne d’une certaine gêne et d’une méconnaissance mutuelle de l’autre. C’est ainsi que lors de rassemblements, il n’est pas rare d’observer une séparation tacite : les Québécois d’un côté, les immigrants de l’autre. Ce n’est pas tant une question de rejet qu’une simple réalité culturelle. Leurs univers sont différents, et ces différences se reflètent dans l’humour, le langage, les codes sociaux et la manière dont chacun se définit.
Un Québécois, par exemple, se présentera volontiers en mentionnant son prénom et son double nom de famille, comme pour affirmer son enracinement dans le territoire. De leur côté, les nouveaux arrivants doivent souvent jongler entre leur identité d’origine et leur volonté d’intégration, un équilibre délicat à maintenir dans un environnement où l’on valorise autant l’authenticité que l’adaptation.
Finalement, si le Québec est une terre d’accueil, il demeure un espace où la cohabitation repose sur des ajustements constants. Les différences ne disparaîtront jamais totalement, et c’est peut-être là que réside la véritable richesse de cette société : accepter l’autre sans chercher à l’assimiler, mais en construisant ensemble un espace commun, où chacun trouve sa place, à sa manière.
De notre correspondant au Québec Dounia MOUNADI