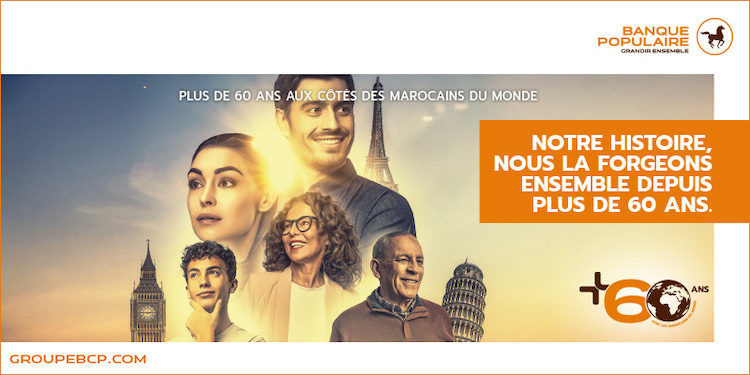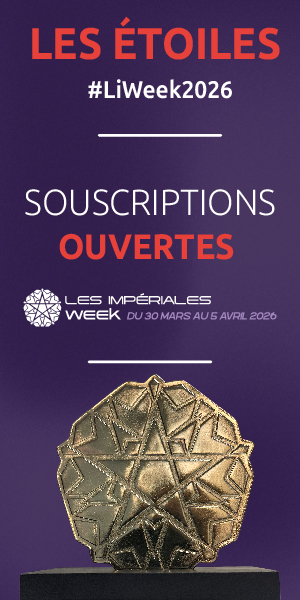Plus de 60 milliards d’euros d’échanges en 2024, près de 9 milliards d’investissements engagés : les relations économiques entre le Maroc et l’Union européenne atteignent un niveau sans précédent. Mais derrière cette dynamique chiffrée, les rapports restent déséquilibrés. C’est ce que pointe le dernier rapport d’Abdessalam Jaldi, publié en octobre 2025 par le Policy Center for the New South, qui décrypte les promesses et les impasses du Nouveau Pacte pour la Méditerranée.
Lancé en 2021 par la Commission européenne, ce programme entend redéfinir les liens entre l’Europe et ses voisins du Sud, dans un contexte géopolitique bouleversé par la pandémie, la guerre en Ukraine et le conflit à Gaza. Doté de 42 milliards d’euros, il articule son action autour de trois axes : résilience humaine, transition verte et numérique, et sécurité. Le Maroc figure parmi les principaux bénéficiaires, avec un portefeuille prévisionnel de 8,7 milliards d’euros jusqu’en 2027, dont 1,6 milliard en subventions.
Depuis trois décennies, le Royaume occupe une place centrale dans l’architecture euro-méditerranéenne. Accords successifs, statut avancé, coopération renforcée : Rabat s’est imposé comme un partenaire stratégique, à la fois stable et engagé. Mais pour M. Jaldi, ce rôle s’accompagne d’une tension persistante entre discours d’égal à égal et réalités asymétriques. Si l’UE évoque la « copropriété » des projets, elle continue de conditionner son aide à l’adoption de priorités externes, parfois éloignées des urgences sociales marocaines.
Le rapport souligne que cette approche maintient une logique de dépendance. En matière de gouvernance, par exemple, les projets financés s’inscrivent dans des cadres normatifs souvent imposés. Les politiques de transparence ou de lutte contre la corruption deviennent des préalables implicites à toute aide européenne, réduisant la marge de manœuvre nationale. L’agenda social, pourtant vital pour nombre de régions du Royaume, reste relégué au second plan.
Certaines pistes de rééquilibrage existent pourtant. La réforme de la protection sociale en constitue une. Pour l’auteur du rapport, c’est un levier stratégique où l’expertise européenne pourrait appuyer les ambitions marocaines, à condition de respecter les choix souverains. Extension de la couverture au secteur informel, digitalisation des dispositifs, gouvernance et financement durable sont autant de chantiers ouverts à une coopération ciblée.
Le domaine industriel offre également un terrain d’intégration plus égalitaire. Le rapport cite le précédent asiatique, avec le rôle moteur du Japon dans le développement des industries de l’ASEAN. Une stratégie similaire pourrait accompagner les secteurs marocains en forte croissance, de l’automobile à l’aéronautique, en passant par les énergies renouvelables et les semi-conducteurs.
Autre levier évoqué, le numérique. Le Maroc s’est doté d’un socle réglementaire solide, que le rapprochement avec les normes européennes, telles que le RGPD ou le Digital Services Act, pourrait renforcer. L’enjeu, selon M. Jaldi, est de bâtir une souveraineté technologique partagée, centrée sur les usagers, plutôt que de glisser vers une dépendance réglementaire.
Le rapport s’attarde aussi sur un point souvent absent des débats euro-méditerranéens : la fuite des compétences. Avec 60 % de ses migrants âgés de moins de quarante ans, le Maroc voit partir une partie de sa jeunesse qualifiée. Le document propose d’explorer des mécanismes de compensation ou d’encouragement au retour temporaire, inspirés d’expériences indienne ou israélienne, pour transformer cette hémorragie en atout économique.
Enfin, sur le plan géopolitique, le Maroc pourrait faire valoir son positionnement dans les grands programmes européens de défense. Des coopérations de haut niveau, comme dans le domaine des drones ou de l’aéronautique militaire, ouvriraient la voie à une intégration technologique plus ambitieuse, en phase avec les mutations de l’espace euro-atlantique.
Reste une condition essentielle : sortir d’une logique de coopération à sens unique. Le rapport le dit clairement, les partenariats ne peuvent reposer durablement sur une hiérarchie des priorités. S’ils ne servent pas en premier lieu le développement humain, les pactes les mieux dotés risquent de raviver les déséquilibres qu’ils prétendent corriger.