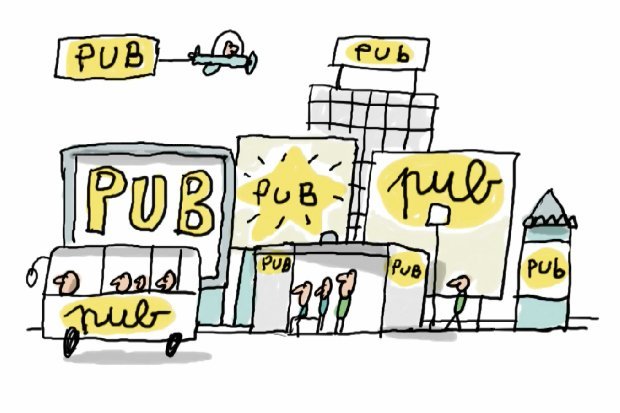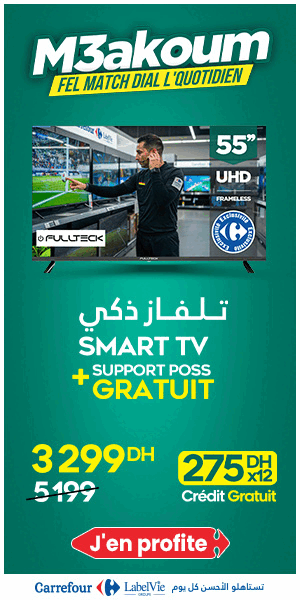Longtemps relégué au second plan, le secteur publicitaire au Maroc peine encore à s’imposer comme un véritable levier de croissance. Il ne pèse aujourd’hui qu’une fraction du produit intérieur brut. À peine 1 %. Un chiffre qui suffit, à lui seul, à mesurer le décalage entre l’importance stratégique de la publicité et sa place réelle dans l’économie nationale.
Le constat est clair. Ce marché reste sous-investi, faiblement structuré et peu soutenu sur le plan institutionnel. Les professionnels parlent d’un secteur encore “non reconnu” dans les politiques publiques, et appellent à une reconsidération complète de son statut économique. La création d’une charte nationale d’investissement, adossée à une régulation spécifique et à une fiscalité adaptée, figure désormais parmi les revendications prioritaires.
Car l’enjeu dépasse la seule question de la communication. La publicité, dans son rôle premier, soutient la demande, stimule la consommation et finance une large part des contenus médiatiques. Dans un contexte de mutation numérique rapide, elle devient aussi un terrain de souveraineté, notamment face aux géants internationaux qui captent une part croissante des budgets. Youtube, Facebook, TikTok, Google Ads… Ces plateformes globales attirent, en silence, une masse d’investissements qui échappent aux circuits nationaux.
L’asymétrie est flagrante. Les opérateurs locaux sont soumis à une fiscalité classique, parfois lourde, tandis que les acteurs étrangers échappent en grande partie aux mécanismes de régulation, profitant de leur implantation hors du territoire. La logique de taxation actuelle, construite sur des principes datant du siècle dernier, ne tient plus face aux nouvelles réalités du marché. Ce déséquilibre alimente une perte de valeur pour l’écosystème marocain, tout en affaiblissant les médias locaux déjà fragilisés.
Le manque de données fiables sur le secteur complique encore la situation. Aucun outil ne permet aujourd’hui de mesurer avec précision les flux publicitaires, notamment dans le digital. L’absence d’un Observatoire certifié des audiences, le retard dans la normalisation des indicateurs et le déficit de transparence freinent toute tentative de réforme structurante. Pour beaucoup, il est urgent de produire une étude nationale de référence, qui dresserait une cartographie exacte des acteurs, des investissements et des usages.
Dans cette perspective, plusieurs propositions circulent. La création d’une plateforme digitale commune, regroupant les principaux médias marocains autour d’un inventaire partagé, sécurisé et traçable, en est une. Ce modèle, déjà testé en Asie du Sud-Est, permettrait de mieux valoriser les espaces publicitaires locaux, d’offrir un cadre de brand safety aux annonceurs, et de consolider la compétitivité des médias nationaux.
D’autres pistes concernent directement la fiscalité. Certains experts suggèrent de revoir le taux d’imposition sur les sociétés pour les entreprises actives dans le secteur, avançant qu’un dirham investi dans la publicité génère jusqu’à quinze dirhams de retombées économiques. Une vision purement budgétaire, sans lecture macroéconomique de la chaîne de valeur, reviendrait donc à négliger un potentiel de croissance non négligeable. L’introduction de mesures incitatives ciblées pourrait élargir la base des annonceurs, notamment en encourageant les PME à communiquer davantage.
La régulation du marché reste également un sujet sensible. Avec la montée en puissance des réseaux sociaux et des logiques de ciblage algorithmique, le paysage publicitaire évolue à grande vitesse, souvent plus vite que le droit. L’intelligence artificielle, les formats automatisés, les marketplaces publicitaires intégrées changent en profondeur les équilibres. Pour les professionnels, il est donc impératif d’anticiper ces mutations, en dotant le secteur d’un cadre juridique souple mais robuste, capable d’encadrer les usages sans freiner l’innovation.
Autre levier identifié : la formation. Le développement d’une industrie publicitaire pérenne passe aussi par la montée en compétence des ressources humaines, la structuration des métiers et la professionnalisation des filières. Aujourd’hui encore, l’accès aux métiers de la publicité reste peu encadré, les parcours sont dispersés et les formations spécialisées rares.
Enfin, subsiste la question des importations de services liés à la publicité. Si les autorités monétaires ont assoupli certaines règles en matière de change pour faciliter les paiements, les professionnels appellent à une clarification du cadre juridique, afin d’assurer un équilibre entre ouverture du marché et protection de la valeur ajoutée locale.
En filigrane, tous les acteurs du secteur de la publicité semblent s’accorder sur une nécessité : ne plus considérer la publicité comme un secteur périphérique. Ce marché, s’il est régulé, investi et structuré, peut devenir un véritable moteur d’innovation, de croissance et de rayonnement culturel. Il reste à franchir ce pas politique.