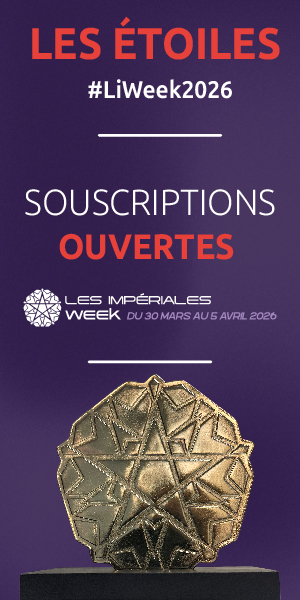Adoptée à Washington le 18 juillet 2025, la Genius Act marque un tournant dans la régulation des monnaies numériques aux États-Unis. Ce texte fondateur impose pour la première fois un cadre fédéral aux stablecoins, ces cryptoactifs conçus pour refléter la valeur du dollar. Portée par les Républicains et soutenue par Donald Trump, cette loi entend consolider le rôle du billet vert dans les échanges numériques mondiaux, tout en positionnant les États-Unis comme chef de file d’un écosystème en quête de légitimité.
Contrairement aux cryptomonnaies volatiles comme le bitcoin ou l’ether, les stablecoins misent sur la stabilité. Indexés sur une monnaie fiduciaire et adossés à des réserves en dollars, ils séduisent par leur fiabilité apparente. Cette caractéristique en fait un outil de choix pour les paiements rapides, les transferts internationaux et la finance décentralisée. Avec la Genius Act, Washington entend capitaliser sur cette dynamique en posant des règles claires, notamment en matière de transparence, de réserves et de supervision.
La portée du texte dépasse largement les frontières américaines. Dans de nombreux pays émergents, les stablecoins servent déjà d’alternative au cash local, trop souvent miné par l’inflation ou les restrictions de change. Joseph Zammit, analyste dans la fintech, y voit une forme de dollarisation numérique. « Le Maroc en est un bon exemple. Bien que les cryptos y soient interdites depuis 2017, près de 6 millions de personnes les utilisent encore, souvent de manière informelle. »
À Rabat, Bank Al-Maghrib travaille à un projet de loi sur les crypto-actifs et expérimente un e-dirham, preuve que le débat avance. L’encadrement américain, en se voulant rassurant et structurant, pourrait servir de catalyseur à cette transition. Les régulateurs marocains devront cependant composer avec les effets secondaires d’un accès facilité aux stablecoins réglementés.
Le premier enjeu concerne les transferts des Marocains résidant à l’étranger, qui ont représenté 11,8 milliards de dollars en 2023, soit près de 8% du PIB. En moyenne, l’envoi de 200 dollars vers la région MENA coûte encore près de 6%, bien au-delà de l’objectif fixé par l’ONU pour 2030. Or, les solutions basées sur la blockchain, comme Bitso entre les États-Unis et le Mexique, ont déjà ramené ces frais sous la barre des 1%. L’essor des stablecoins validés par Washington pourrait accélérer ce basculement.
À terme, cette évolution menace de réduire le besoin de conversion en dirhams, diminuant mécaniquement l’entrée nette de devises. Le Trésor devra aussi anticiper d’éventuelles tensions de liquidité en cas de retraits massifs. Par ailleurs, sans cadre local adapté, les autorités perdront en visibilité sur les flux, d’où la nécessité de mettre en place des mécanismes de suivi tels que des portefeuilles agréés.
L’impact se fera également sentir sur les opérateurs traditionnels. Face à des stablecoins à la fois rapides, peu coûteux et désormais encadrés, les géants comme Western Union ou MoneyGram verront leur modèle fragilisé, notamment dans les zones rurales où la dématérialisation pourrait accroître l’exclusion financière.
Le contexte mondial conforte ce basculement. Les paiements transfrontaliers ont déjà atteint 194.800 milliards de dollars en 2024, dont 40.000 milliards hors transactions interbancaires. Les stablecoins ne représentent encore qu’une infime portion de ces flux, mais leur potentiel est immense. Les prévisions estiment leur marché à près de 16.500 milliards dans les prochaines années, principalement dans les échanges B2B.
Des groupes comme Stripe, qui a racheté Bridge en 2024, ou MoneyGram, déjà partenaire de l’USDC, misent sur cette croissance. Les volumes parlent d’eux-mêmes : 5.700 milliards en 2024, puis 4.600 milliards dès le premier semestre 2025.
Avec la Genius Act, les États-Unis offrent aux entreprises crypto un cadre légal pour se structurer et se développer, tout en réduisant les risques réglementaires. C’est une avancée que beaucoup de pays, Maroc compris, ne pourront ignorer bien longtemps.